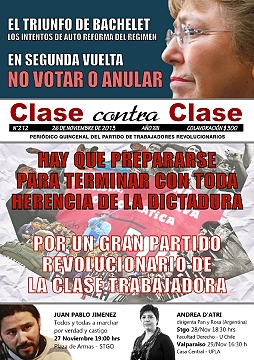III Conférence de la FTQI
La situation Internationale et les tâches des marxistes révolutionnaires aujourd’hui (II)
16/05/2005
INSTRUMENTS PROGRAMMATIQUES
1. LE MOUVEMENT ANTIGUERRE ET LA GUERRE/ OCCUPATION EN IRAK
L’émergence du mouvement contre la guerre a été un phénomène progressiste. La mobilisation de millions de personnes sur les cinq continents contre l’invasion militaire de l’Irak a été l’opposition la plus importante à la politique de Bush dans son ambition de redessiner le monde et le Moyen-Orient en sa faveur. Malgré des hauts et de bas, cela reste un facteur présent dans la réalité mondiale. Après les attentats de Madrid, les mobilisations contre la guerre ont obligé le gouvernement espagnol ã retirer ses troupes de la coalition pro-étasunienne. En Angleterre, malgré sa réélection, Blair a perdu beaucoup de votes en raison de l’intervention en Irak aux cotés de Bush.
En Europe cependant, là où le mouvement contre la guerre a été le plus important, les directions syndicales, les syndicats « alternatifs » et « combatifs » comme IGM en Allemagne, SUD en France, le syndicalisme de base en Italie, les directions du mouvement altermondialiste comme ATTAC et même les néo-autonomistes n’ont rien fait pour que ce mouvement se transforme en une force efficace contre la machine de guerre étasunienne. Dès le début de la guerre ces directions ont misé sur le développement du pacifisme en créant des illusions au sujet des puissances européennes opposées à la guerre ou par rapport à l’ONU.
La seule possibilité d’enrailler les préparatifs de guerre consistait cependant ã arrêter la machine militaire. La « machine de guerre », c’est les Etats et les gouvernements, les bourgeoisies impérialistes qui la financent et qui espèrent en tirer profit. Seule une grande lutte contre les gouvernements des pays agresseurs pouvait arrêter l’agression impérialiste voir même se transformer en une lutte sociale contre les gouvernements impérialistes. Mais hormis quelques actions isolées, les directions du mouvement antiguerre ont empêché que la classe ouvrière avec son programme et ses méthodes soit le centre de gravité de la lutte contre la guerre en mettant tout en œuvre pour une grève générale, le boycott et le sabotage de l’industrie et du transport militaires .
C’est pour cela que la politique des marxistes révolutionnaires contre la guerre reste la combinaison du défaitisme révolutionnaire dans les pays agresseurs -appuyé sur le mouvement antiguerre tout en luttant pour lui faire dépasser sa phase pacifiste actuelle (progressiste dans les pays impérialistes agresseurs)- et de la lutte ouverte contre les gouvernements impérialistes comme ceux de Bush, Blair ou Berlusconi. Les expériences de la guerre de libération algérienne contre l’impérialisme français ou de la lutte héroïque du peuple vietnamien contre l’armée étasunienne ont démontré que la combinaison de la résistance dans les pays opprimés et la mobilisation au sein des puissances impérialistes mènent à la défaite des plus grandes armées du monde.
Une telle politique révolutionnaire ne peut se développer qu’à partir de la lutte ouverte contre les directions et les idéologies pacifistes qui condamnent par principe toute guerre en tant « qu’immorale », traçant un signe d’égalité entre la violence contre-révolutionnaire des oppresseurs et le combat légitime des opprimés. Ainsi, le point de départ de tout programme révolutionnaire est de définir la guerre en Irak comme une agression impérialiste contre une nation opprimée. Sous le masque de la « démocratie », le gouvernement de Bush essaie de liquider la souveraineté nationale de l’Irak afin de contrôler son peuple et exploiter et piller ses richesses. Toute guerre de défense et de libération nationales, comme l’ont été la lutte pour la libération nationale algérienne contre la colonisation française ou la guerre du Vietnam, est pour les révolutionnaires une guerre juste. Dans ce type de guerre, les révolutionnaires se situent militairement aux côtés des pays semi-coloniaux indépendamment du caractère du régime en place car le triomphe d’un pays impérialiste signifierait une double chaîne d’oppression pour le peuple de la nation semi-coloniale. Dans le cas de l’Irak, nous sommes pour la défaite de l’impérialisme étasunien et de sa coalition et ce en dépit du caractère réactionnaire et dictatorial du régime de Saddam Hussein. Nous suivons ainsi les enseignements du marxisme révolutionnaire développés par Trotsky face ã une éventuelle guerre entre le régime semi-fascite de Getulio Vargas au Brésil et l’Angleterre impérialiste dans les années 1930. « Je répondrai pour ma part que dans ce cas, affirmait alors Trotsky, je serai du côté du Brésil « fasciste » contre l’Angleterre « démocratique ». Pourquoi ? Parce que, dans le conflit qui les opposerait, ce n’est pas de démocratie ou de fascisme qu’il s’agirait. Si l’Angleterre gagnait, elle installerait ã Rio de Janeiro un autre fasciste, et enchaînerait doublement le Brésil. Si au contraire le Brésil l’emportait, cela pourrait donner un élan considérable à la conscience démocratique et nationale de ce pays et conduire au renversement de la dictature de Vargas. La défaite de l’Angleterre porterait en même temps un coup à l’impérialisme britannique et donnerait un élan au mouvement révolutionnaire du prolétariat anglais ». C’est pour cela que le premier point de notre programme révolutionnaire face à la guerre en Irak a été celui de la défaite des troupes impérialistes. Mais se situer dans le camp de la nation opprimée ne signifie pas comme le font les courants populistes se situer du coté de sa direction éventuelle. Comme l’a démontré l’histoire du XXème siècle, l’histoire de la dictature militaire argentine lors de la Guerre de Malouines contre l’impérialisme britannique par exemple ou celle de Saddam Hussein au cours des deux guerres du Golfe, la bourgeoisie nationale d’une nation opprimée est incapable de prendre les mesures militaires et politiques nécessaires à la défaite de l’impérialisme. La peur de la lutte de classe et le refus à l’armement généralisé de la population démontrent que les directions bourgeoises nationales préfèrent une défaite face à l’impérialisme plutôt qu’une remise en cause de leur domination de classe. Ainsi, les révolutionnaires appuient la nation opprimée au niveau militaire et c’est depuis cette tranchée que nous défendons notre programme qui doit combiner les tâches de libération nationale avec la méthode et les objectifs de la révolution prolétarienne.
En ce sens, nous luttons pour disputer à la bourgeoisie nationale la direction de la guerre dans la mesure ou elle finit systématiquement par capituler et par infliger des défaites nationales démoralisantes. La seule classe capable d’unifier et de diriger l’ensemble des couches opprimées est le prolétariat. Il est le seul capable de mener une lutte jusqu’à la victoire contre l’impérialisme en prenant comme horizon la stratégie révolutionnaire et internationaliste.
En Irak, seule une action indépendante de la classe ouvrière et des masses iraquiennes aurait pu défaire l’envahisseur. Leur triomphe aurait été un point d’appui extraordinaire dans la lutte contre l’exploitation et pour la liberté de tous les peuples de la région et du monde.
C’est cette même logique qu’il faut mettre en avant aujourd’hui sous l’occupation militaire et face au développement de la résistance. De nombreux secteurs qui hier s’opposaient à la guerre, la considérant comme injustifiée, se refusent de lutter pour le triomphe des masses de ce pays occupé en soulignant le caractère islamique de la résistance. Ceci est un faux raisonnement. Il ne pose d’ailleurs pas la question de la défaite de l’impérialisme. Un triomphe des masses iraquiennes donnerait une impulsion ã tous les peuples du Proche et Moyen-Orient, remettant en cause la domination impérialiste sur cette zone stratégique qui concentre les principales réserves de pétrole et mettant en péril la domination des bourgeoisies locales. En même temps, la lutte du prolétariat et des masses des pays centraux serait dynamisée par la défaite de l’impérialisme en Irak en raison de l’affaiblissement subséquent des gouvernements agresseurs comme cela avait été par exemple le cas lors de la guerre du Vietnam. C’est seulement ã partir de cette orientation qu’il est possible de lutter effectivement pour une direction et un programme clairement anti-impérialiste qui mène à la victoire la nation opprimée. C’est en ce sens qu’il faut dénoncer, tout d’abord, la collaboration du clergé chiite et de Al Sistani avec les troupes étasuniennes. Dans un second temps, il faut remettre en cause les formes de résistance des secteurs sunnites qui donnent ã cette lutte un caractère tribal au sein desquels une minorité fondamentaliste islamique utilise des méthodes brutales, comme les attentats contre la population chiite, renforçant ainsi l’occupation impérialiste. Seule une direction qui cherche ã transformer la classe ouvrière en classe dirigeante de la nation opprimée pourra unir la population contre l’invasion impérialiste et devenir la source d’inspiration des peuples opprimés de la région et être un exemple dans le monde entier.
Le renouveau des phénomènes religieux
Les classes dominantes ont historiquement utilisé la religion pour renforcer la soumission des classes exploitées en prêchant la patience et l’inévitabilité de la misère et l’oppression, justifiant la souffrance sur cette terre par une vie meilleure au delà de la mort. Pendant ce temps, au cours des siècles, l’Eglise catholique et les Eglises protestantes accumulaient richesses et pouvoir politique. Cette double morale cléricale se manifeste ã tous les niveaux. Pendant la dictature en Argentine, l’Eglise catholique était complice du terrorisme d’Etat.
Aujourd’hui, alors que prêtres et curés sont accusés d’abus sexuels sur mineurs, le discours répressif du Vatican en faveur de la chasteté et discriminatoire quant à la sexualité est particulièrement obscène.
Marx, quant à lui, définissait la religion comme « l’opium des peuples ». En tant que marxistes révolutionnaires nous sommes athées et nous luttons contre l’ingérence religieuse dans la vie publique. Nous défendons et luttons pour la conquête de droits démocratiques comme le droit à l’avortement et pour le libre choix de sa sexualité. Cependant, nous faisons la différence entre notre combat contre les institutions et les hiérarchies religieuses réactionnaires et notre tâche de persuasion patiente envers les masses ouvrières et populaires de notre vision matérialiste du monde et des rapports sociales. Ceci a évidemment des conséquences programmatiques. Par exemple, la politique des bolcheviques envers les populations orientales de l’ex-empire tsariste consistait à leur garantir leurs pleins droits à l’autodétermination nationale et le respect de leurs traditions culturelles.
Même si dans le « monde occidental », les Eglises et les hiérarchies religieuses ne gouvernent pas, nous assistons ces dernières années ã une augmentation du pouvoir ecclésiastique et de son influence sur la vie politique. Les exemples foisonnent. Aux Etats-Unis, la droite chrétienne est un des grands soutiens du gouvernement de Bush. Dans un climat réactionnaire, elle pousse aux attaques contre les libertés démocratiques à l’image des campagnes contre l’avortement, contre le caractère laïc de l’éducation, contre les libertés sexuelles ou contre encore le mariage homosexuel. Cette offensive est effectivement apparue au grand jour en Espagne sous le gouvernement Aznar. Bush en personne se sent « inspiré par Dieu » et justifie ses politiques impérialistes par des termes inspirés du discours religieux. « Croisade » ou « axe du mal » rappellent effectivement les guerres saintes. Certains idéologues étasuniens parlent même de « guerre des civilisations » et définissent les peuples musulmans comme une « menace pour la démocratie occidentale ». L’Eglise catholique reste un pilier de l’ordre capitaliste comme l’a démontré le Pape Jean-Paul II lors du processus de restauration capitaliste en Pologne et dans les pays d’Europe de l’Est.
Pour ce qui est du sionisme, mouvement théocratique, il se définit par son caractère colonial et pro-impérialiste et s’est développé avec pour objectif la création d’un Etat exclusivement juif en Palestine. En 1948, cette entreprise s’est matérialisée par la création de l’Etat d’Israël sur les bases du nettoyage ethnique du peuple palestinien et a donné lieu ã une enclave raciste qui justifie ses politiques expansionnistes sur tout le territoire et l’oppression du peuple palestinien par le recours à la Thora. Les partis religieux y ont un poids très important et les partisans les plus radicaux du sionisme sont en majorité des colons qui vivent dans les territoires occupés, constituant de véritables groupes de choc contre la population palestinienne.
Cependant, la religion est aussi reprise comme drapeau par différents mouvements qui de façon détournée expriment les mécontentements des opprimés. C’est le cas des directions islamiques de la lutte palestinienne ou celles de la résistance iraquienne contre l’occupation étasunienne.
Le caractère réactionnaire des directions confessionnelles
L’échec historique du nationalisme bourgeois arabe est à la base de ce que l’on connaît comme « l’Islam politique ». En reprenant un discours anti-étasunien et antisioniste, l’Islam politique touche d’important secteurs radicalisés des masses arabo-musulmanes. On songera par exemple au Hamas palestinien ou au Hezbollah libanais.
L’instrumentalisation active de la religion pour des objectifs politiques s’est accentuée ã partir des années 1960 afin d’affronter les tendances nationalistes et laïques. Cette politisation de la religion a été d’autant plus importante avec le triomphe de la révolution iranienne en 1979 qui s’est terminée, après la liquidation de son aile de gauche, par la mise en place d’un régime théocratique réactionnaire avec ã sa tête l’ayatollah Khomeiny. Cependant, alors que le chiisme radical de la révolution iranienne attirait la sympathie de la jeunesse pauvre et marginalisée qui voulait la transformer en un mouvement anti-impérialiste, l’Arabie Saoudite, alliée inconditionnelle des Etats-Unis et grand pole religieux, diffusait dans les pays musulmans une variante de l’Islam, le wahhabisme, bien plus conservatrice et finançait la construction de mosquées et de madrasas pour contrecarrer l’expansion de la révolution iranienne. Dans les année 1980, ce « pétro-Islam » a financé la djihad afghane qui luttait contre l’Union Soviétique et un régime prosoviétique antipopulaire soutenu par les troupes de l’Armée Rouge. Les Etats-Unis appuyaient et finançaient les militants de la djihad qu’ils appelaient alors « les combattants de la liberté » développant le caractère anticommuniste et réactionnaire de ce mouvement qui une décennie plus tard finirait par expulser l’Armée Rouge, accélérant par là même la chute de l’Union Soviétique. Mais les groupes armés qui agissaient en Afghanistan sous la direction d’Osama Ben Laden ont développé leur propre dynamique et ont donné naissance au gouvernement réactionnaire des talibans et au réseau Al Qaeda. Cette organisation s’est transformée par la suite en ennemi numéro un des Etats-Unis et de la monarchie saoudienne qui n’avaient plus besoin des services de ces groupes islamiques après la disparition de l’Union Soviétique et la liquidation du nationalisme.
Ainsi, les organisations comme Al Qaeda, les talibans ou encore le GIA algérien sont des organisations complètement réactionnaires qui oppriment les femmes, infligent des châtiments « exemplaires » ã tous ceux qui n’obéissent aux préceptes religieux et qui ne différencient absolument pas les travailleurs et les civils lors de leurs attentats, les transformant généralement en premières victimes de leurs attentats comme l’ont montré les bombes de Madrid en mars 2004. D’autres organisations comme le Hezbollah libanais, le mouvement de la Résistance Islamique (Hamas) et la Jihad Islamique en Palestine ou certains secteurs de la résistance iraquienne tirent cependant leur légitimité, même pour mener ã bien des actions militaires « terroristes » afin d’affronter des puissances bien supérieures militairement, au fait qu’ils font partie de mouvements plus larges de libération nationale.
En tant que révolutionnaire nous défendons les militants de ces organisations islamiques radicales contre les attaques des forces réactionnaires qu’elles soient impérialistes ou de l’Etat d’Israël. Nous défendons le droit de l’Iran ã résister aux pressions des impérialismes étasunien et européen. Nous défendons les droits démocratiques des communautés musulmanes en Occident qui subissent les attaques des gouvernements impérialistes, comme par exemple aux Etats-Unis où les Arabes sont suspects et peuvent être incarcérés et torturés sans procès dans des prisons clandestines. Nous défendons aussi leurs droits culturels comme le port du voile pour les jeunes filles musulmanes, si elles le souhaitent, contre les attaques des gouvernements impérialistes dans un pays « démocratique » comme la France .
C’est ã partir de cette position anti-impérialiste que nous combattons les directions islamiques qui poursuivent une stratégie réactionnaire de mise en place de régimes théocratiques visant à liquider toutes les libertés démocratiques et se posant en ennemis résolus de la libération des travailleurs, des exploité-e-s et des opprimé-e-s. L’illusion d’une « communauté de croyants » cache en réalité les divisions entre classes dans la société islamique. C’est là l’ennemi de la classe ouvrière qui est la seule qui, à la tête des masses opprimées et sur la base d’une politique indépendante, peut affronter l’impérialisme et ses gouvernements locaux. Une fois au pouvoir, les islamistes se sont révélés être les agents des classes capitalistes locales et ont maintenu des régimes répressifs contre la grande majorité du peuple. C’est en ce sens qu’au-delà de leur démagogie sociale et des contradictions qu’ils peuvent avoir avec les Etats-Unis, ces directions islamiques constituent les principaux obstacles à la révolution ouvrière et socialiste.
2. CONTRE L’EUROPE DU CAPITAL, POUR LES ETATS-UNIS SOCIALISTES D’EUROPE
L’Union Européenne (UE) est un projet d’accord interétatique dirigé par les bourgeoisies impérialistes des pays les plus forts d’Europe Occidentale pour entrer dans la compétition de la domination du monde et de ses marchés contre les Etats-Unis en phase de déclin hégémonique. A la différence de la vieille CEE, cet accord interétatique est composé par des pays impérialistes et des pays de l’Europe de l’Est en voie de semi-colonisation.
Dans cette première phase de guerre économique, l’objectif est triple : construire un espace douanier relativement compact face à la concurrence extérieure et favoriser la concentration capitaliste au niveau régional, augmenter la productivité relative et diminuer les coûts du travail au niveau européen, approfondir la pénétration impérialiste européenne dans le pré carré semi-colonial externe -en Afrique, Asie ou Amérique Latine- et institutionnaliser la domination dans son pré carré semi-colonial interne comme dans les pays récemment intégrés, faisant par la même pression sur les républiques de l’ex-URSS et sur la Russie.
Le caractère de ce projet est entièrement réactionnaire et anti-ouvrier. Il cherche ã utiliser la main d’œuvre bon marché et qualifiée des pays de l’Est pour attaquer les conquêtes des travailleurs des pays impérialistes qui subsistent par la mise en place des différents plans des bourgeoisies du continent comme l’a été en Allemagne l’Agenda 2010 de Schröder ou la remise en cause des 35 heures en France. Ces politiques néolibérales et impérialistes des Etats membres correspondent aux directives qui se négocient au sein de la Commission et du Parlement européens développant l’hostilité ou l’indifférence des travailleurs face à l’actuel processus de construction de l’UE. Ceci s’est manifesté par le triomphe du « non » en France en mai 2005 lors du référendum sur le Traité Constitutionnel Européen. Ce référendum a été vu par la jeunesse et les travailleurs comme un outil pour rejeter en bloc ce projet constitutionnel anti-ouvrier et anti-populaire et pour sanctionner le gouvernement Raffarin-Chirac, l’Europe du capital et sa constitution ouvertement néolibérale. Même si le « non » a été un vote hétérogène tant au niveau social que niveau politique –l’extrême droite appelait ã voter « non » au même titre que la gauche politique et syndicale, d’anciens ministres sociaux démocrates ou encore les partis d’extrême gauche LO, LCR et PT-, il a essentiellement des caractéristiques ouvrières et populaires à la différence du vote hollandais où primait le chauvinisme.
Cette défaite pour le président Chirac et la classe politique française a ouvert une importante crise au sein du gouvernement mais également au sein du parti socialiste qui avait appelé ã voter « oui » laissant ainsi apparaître ses divisions internes.
Cette crise politique en France, axe de la construction européenne, a lieu dans un contexte de ralentissement économique dans les pays les plus forts de l’UE, dans un contexte de crise sociale –plus de 10% de chômeurs- et de crise culturelle et d’identité face aux changements au sein de l’UE et à l’incorporation des pays de l’Est. La crise de ceux d’en haut pourrait être utilisée par le mouvement de masse pour passer à l’offensive.
L’autre forme de l’attaque des conquêtes des travailleurs des pays centraux passe par l’incorporation des pays de l’Est de l’Europe où l’on peut clairement voir le caractère impérialiste de l’UE. A la différence de l’adhésion de la Grèce, de l’Espagne et du Portugal qui avaient dû restructurer leurs économies mais avaient profité des aides européennes, aucun des pays de l’Est n’aura droit ã un tel traitement.
Bien au contraire, les montants assignés à l’ensemble des nouveaux membres seront bien inférieurs aux cent milliards de dollars que l’Allemagne avait pu assigner aux « nouveaux landers » de l’Est afin d’atténuer les conflits sociaux pouvant survenir avec la réunification. Il n’est pas surprenant qu’avec cette politique et malgré la reprise économique de ces dernières années, nombre de ces pays de l’Est soient encore en dessous du niveau de production de 1989. La restauration capitaliste avec ses hausses de tarifs de l’électricité, des loyers, du transport, de la santé, ses privatisations de services publics -qui étaient auparavant gratuits et associés à l’emploi dans les grandes entreprises-, l’augmentation des prix des produits agricoles a signifié une importante régression sociale. Le démantèlement des grandes entreprises publiques n’a absolument pas été compensé par la croissance des petites entreprises privées, très souvent précaires, ni par les investissements étrangers. Ainsi, le chômage -plus de 20% en Pologne-, la précarité, les inégalités régionales et sociales n’ont cessé d’augmenter et touchent particulièrement les femmes entraînant un développement important de la prostitution, du travail au noir et ou même du repli sur de petites parcelles de terrain, unique source de « sécurité sociale ».
A partir de ces différences structurelles, deux dynamiques révolutionnaires surgissent, l’une plus proche de celle des pays semi-coloniaux où les revendications démocratiques et agraires sont essentielles, et l’autre, celle d’une révolution prolétarienne qui affronte le capital, subséquente des pays avancés. Oublier ce caractère du programme et prendre l’UE comme une entité homogène, comme le font les altermondialistes, peut nous amener ã défendre une série de revendications inutiles au développement de la mobilisation révolutionnaire des masses qui dans le pire des cas peut conduire ã ne pas lutter contre son propre impérialisme cédant ainsi aux pressions social-chauvinistes de la bureaucratie syndicale et de l’aristocratie ouvrière.
Malgré toutes les avancées réalisées, l’UE n’est pas un Etat et n’est pas en passe de le devenir. C’est une alliance, aujourd’hui défensive, visant ã se transformer en plateforme offensive par rapport aux Etats-Unis et aux autres blocs impérialistes. Pour l’instant, les contradictions nationales entre les différents pays membres de l’UE sont passées au second plan afin de pouvoir se positionner au mieux face ã Washington. Cependant, cela ne signifie pas que les pays impérialistes d’Europe occidentale n’aient pas des intérêts opposés. C’est en ce sens que l’unification de l’Europe par la bourgeoisie est une utopie. Ceci ne signifie pas que la classe ouvrière ait ã appuyer des projets bourgeois alternatifs à la UE, qu’ils soient « nationaux » ou « autarciques » et qui ne font qu’embellir les vieux Etats impérialistes. La position des révolutionnaires ne peut être que « Non à l’Europe du capital, non aux vieux Etats nationaux ! Pour des gouvernements ouvriers révolutionnaires ! Pour une Europe Ouvrière et Socialiste ! ». La seule classe capable d’unifier le continent est la classe ouvrière hégémoniste sur ses alliés de classe, ce qui entraînerait la transformation révolutionnaire socialiste du continent .
3. AMERIQUE DU SUD : LA REGION LA PLUS AVANCEE DE LA LUTTE DE CLASSES INTERNATIONALE
Malgré les alternances gouvernementales « progressistes » dans plusieurs pays grâce auxquelles la bourgeoisie a pu contenir les tendances à l’émergence sur le devant de la scène du mouvement de masses, l’Amérique du Sud continue ã être la région la plus avancée ã échelle internationale du point de vue de la lutte de classes. L’épicentre en est la Bolivie où le processus révolutionnaire qui a déjà mené à la chute de deux gouvernements, celui de Sánchez de Lozada en 2003 et celui de Mesa en juin 2005, reste ouvert.
Malgré un certain retard, l’activité grandissante des masses et les crises politiques en Amérique centrale –manifestations anti-gouvernementales au Nicaragua et au Panama d’un côté, l’intervention impérialiste ã Haïti de l’autre- montrent que l’instabilité structurelle s’étend à la quasi-totalité du continent latino-américain.
La situation de ce point de vue est inégale en Amérique du Sud. Dans les pays du Mercosur , dans le cadre d’une reprise économique importante et en raison de l’effet politique des alternances gouvernementales, il existe une plus grande « contention » du processus de lutte de classes bien que la lutte revendicative de secteurs importants de la classe ouvrière ait considérablement augmenté. Cela ne veut cependant pas dire que ces pays puissent connaître une stabilisation à long terme ni même une résolution de la crise organique de domination bourgeoise dont les mécanismes et institutions sont entrés en crise après deux décennies d’application des programmes néolibéraux dans le cadre des démocraties bourgeoises semi-coloniales. Cela ne veut pas non plus dire que ces pays verront une interruption des processus de recomposition du mouvement ouvrier et de masse.
Dans les pays andins, l’instabilité continue ã primer ainsi qu’une tendance grandissante à l’action directe et à l’intervention du mouvement de masse comme le montrent clairement les processus bolivien et équatorien.
Du point de vue économique, après plusieurs années de récession et de chaos économique comme l’a montré la faillite du système de la « convertibilité » argentine, la reprise économique -5% de croissance moyen dans la région- favorise les affaires de la bourgeoisie et améliore conjoncturellement la situation sur le front du chômage. Cela ne signifie pas pour autant une « redistribution » des richesses nationales comme le promettaient les progressistes ni un desserrement de l’étau impérialiste et encore moins la diminution de l’énorme polarisation sociale et de l’aggravation des conditions de vie et de travail de la classe ouvrière.
Mais il existe en même temps des frictions face à la pression que l’impérialisme étasunien fait peser sur une région qu’il considère historiquement comme son pré carré. Washington s’est embarqué dans une offensive visant ã recomposer son hégémonie ã niveau mondial, avec des tendances toujours plus prédatrices, interventionnistes et militaristes comme le montre l’occupation de l’Irak. Au Sud du Rio Grande, cela implique discipliner et avancer dans la recolonisation de l’Amérique latine. Cependant, loin de remporter un franc succès, les Etats-Unis ne réussissent pas ã inverser la tendance à l’érosion de leur hégémonie politique et économique, même en Amérique latine. Washington a même dû renoncé ã son projet original de libre-échange continental (ZLEA) ou ã certains de ses desideratas tel que l’immunité pour ses troupes. La Maison Blanche ne réussit pas non plus ã isoler le Venezuela et a perdu de précieux soutiens à la suite de la chute des gouvernements équatorien et bolivien.
Tel est le panorama général, et ce malgré un amortissement de la concurrence inter-impérialiste sur le continent. L’Europe se concentre davantage sur la construction de l’UE et sa pénétration vers les PECO alors qu’en Amérique latine les bourgeoisies européennes se mettent d’accord avec Washington pour défendre leurs multinationales ce qui diminue considérablement la marge de manœuvre européenne voulant apparaître comme une « alternative amicale » face ã Washington –ce qui n’exclut cependant pas certaines exceptions comme le montre l’accord signé entre Zapatero et Chávez-. Cela diminue également les marges de manœuvres des bourgeoisies locales pour jouer sur les contradictions inter-impérialistes.
L’heure n’est plus à la discipline mécanique qui primait au cours des années 1990 et que Washington défendait sous la houlette du « Consensus de Washington ». Alors que la domination yankee pèse davantage sur le Mexique et l’Amérique centrale, ses positions au Sud du canal de Panama se sont affaiblies. Ces réalignements polarisent l’ordre régional entre les Etats. Nous trouvons d’une part une aile davantage pro-Washington dont font notamment partie le Chili et la Colombie, et de l’autre des pays au discours démagogiquement « latinoaméricaniste » autour du Brésil. Ces derniers essaient timidement de négocier dans de meilleures conditions leur subordination à l’impérialisme sans pour autant former un bloc uni. En témoignent leurs différentes politiques nationales et les frictions constantes entre les Etats de la région.
Dans certains pays assiste à l’apparition, avec un rythme et une intensité distincts, de « crises nationales générales » qui voient se combiner la faiblesses structurelle du capitalisme semi-colonial, les crises politico-étatiques –expression des crises organiques de domination bourgeoise- et des niveaux importants de lutte de classes qui ont inversé, contre la classe dominante, les rapports de force généraux. Cela est plus particulièrement visibles dans la région andine qui continue ã être actuellement la zone de plus grande instabilité politique et de tensions extrêmes entre tous les antagonismes sociaux.
En Bolivie se combinent de manière explosive plusieurs facteurs décisifs : le caractère prédateur du pillage impérialiste des ressources naturelles, la profondeur de la « crise nationale générale » du capitalisme le plus faible et pauvre d’Amérique du Sud ainsi que l’émergence du mouvement de masse qui a une grande tradition de combativité et de radicalité de ses méthodes de lutte et de ses revendications. C’est dans ce cadre générale qu’ont éclaté les journées de manifestations massives qui ont mis fin au gouvernement Mesa en Bolivie et ont freiné la tentative de l’oligarchie crucègne de l’Est du pays de s’emparer du pouvoir, tendant ainsi ã renouer avec le chemin ouvert par le soulèvement d’octobre 2003.
Fin avril 2005, le gouvernement de Gutiérrez, ancien leader du soulèvement du 21 janvier 2000, est tombé sous les coups d’un nouveau soulèvement populaire. Celui qui était arrivé au pouvoir « pour en finir avec la corruption et récupérer la souveraineté nationale » avait fini par se réaligner derrière l’impérialisme et la réaction intérieure. Incapable d’imposer le virage bonapartiste nécessaire pour se placer au dessus des contradictions auxquelles il avait ã faire face, incapable de calmer la droite patronale, après avoir perdu le soutien de l’extrême gauche et de l’indigénisme grâce ã qui il était arrivé au pouvoir, sa chute illustre les limites du « progressisme » latino-américain dans les pays où la faiblesse du capitalisme local et la crise politico-sociale extrême réduit considérablement les marges de manœuvre de ce type de gouvernement de contention.
Au Pérou le gouvernement agonisant de Toledo -qui lui aussi était arrivé au pouvoir à la suite de la chute de Fujimori en tant que garant de la « transition démocratique »- survit malgré un énorme discrédit, des scandales de corruption, la décomposition de son propre parti et une effervescence impressionnante du mouvement de masse. Il espère durer jusqu’aux élections grâce au rôle de contention que joue l’APRA et d’autre forces politiques du régime et notamment grâce au frein qu’impose dans les mobilisations la Centrale Générale des Travailleurs Péruviens (CGTP) et ses différentes sous-fractions bureaucratiques, apristes, staliniennes et maoïstes.
Le cycle ascendant de lutte de classes ã niveau régional se poursuit. L’émergence d’un nouveau mouvement de masse avec des tendances à l’action directe, au combat urbain, aux barrages routiers, aux piquets, aux grèves, aux soulèvements continus des exploités ayant conduit au renversement de plusieurs gouvernements démocratiquement élus se sont transformés en constantes de ce début de XXI° siècle. Les moments les plus tendus de ces processus ont sans doute été les actions indépendantes du mouvement de masse dans des pays comme l’Argentine en 2001 lors de la chute du gouvernement De La Rúa, la défaite de la tentative putschiste et de la grève patronale du secteur pétrolier organisées contre le gouvernement Chávez et surtout les journées révolutionnaires boliviennes d’octobre 2003, véritable répétition générale qui a posé la question des tendances à l’insurrection et à la prise du pouvoir de la part des exploités bien que ceux-ci n’aient pu résoudre ces questions en raison de l’absence d’une direction révolutionnaire. La profondeur de la crise bolivienne a mené à l’ouverture d’un nouvel acte de ce processus révolutionnaire en juin 2005 lorsque le gouvernement Mesa est tombé après deux semaines d’une intense activité du mouvement de masse.
L’instabilité politique et le climat de révolte qui traversent le continent avec des explosions massives et d’innombrables luttes ouvrières, paysannes et populaires sont alimentés par l’impact économique de deux décennies d’application des politiques néo-libérales de pénétration accrue du capital étranger et de l’aggravation de la domination impérialiste qui ont aiguisé les contradictions du capitalisme semi-colonial latino-américain, les antagonismes sociaux et les crises politiques qui rongent ã degré divers les régimes et les gouvernements bourgeois. Bien qu’au cours des deux années passées la région ait connu une importante reprise économique due aux exportations de matières premières liées à la reprise économique au niveau mondial, les tendances à l’instabilité continuent ã exister comme en témoignent les derniers événements de juin 2005 en Bolivie.
Ce nouveau cycle de la lutte de classes en Amérique latine a des caractéristiques plus urbaines. En témoignent le rôle important joué par les pauvres des grandes villes et le rôle embryonnaire joué par le prolétariat organisé comme l’ont montré les mineurs de Huanuni au cours des journées d’octobre 2003 en Bolivie, les expériences avancées de contrôle ouvrier et les luttes salariales en Argentine et les phénomènes de regroupement de l’avant-garde ouvrière au Brésil. C’est là une des grandes différences par rapport à la décennie passée au cours de laquelle les acteurs principaux des mouvements sociaux étaient la paysannerie et les peuples indigènes comme en témoignent le soulèvement zapatiste de 1994, le Mouvement des Sans-Terre (MST) au Brésil, le mouvement paysan paraguayen ou encore les manifestations massives ayant conduit à la chute des présidents équatoriens Bucaram en 1997 puis Mahuad en 2000. Cela ne nie en aucune manière que ces alliés stratégiques du prolétariat n’aient pas ã jouer à l’avenir un rôle très important. En témoignent en Bolivie par exemple la place déterminante des paysans et des indigènes de l’Altiplano et des cultivateurs de Coca du Chapare. Aujourd’hui cependant, comme le montrent les tendances qui s’expriment en Argentine et au Brésil, la recomposition du mouvement de masse s’exprime également ã travers une récupération lente mais soutenue du mouvement ouvrier industriel et des services concentré dans les grandes villes.
Les alternances gouvernementales « progressistes » cherchent ã répondre ã cette situation de manière ã recomposer l’équilibre bourgeois. Face à la crise et au mécontentement généralisé du mouvement de masses généré par l’augmentation du pillage impérialiste dans la région, les bourgeoisies locales se sont vues obligées de recourir ã un changement de leur personnel politique afin de remiser les anciens gouvernements néo-libéraux usés par le pouvoir. Ces gouvernements plus réformistes ont pour objectif de contenir les tendances à la radicalisation dans les pays ayant connu des explosions sociales ou éviter de telles explosions dans les pays où la situation sociale est moins implosive. Les gouvernements de Lula, Kirchner ou Tabaré Vázquez en Uruguay expriment ã des degrés divers des projets de conciliation de classe de manière ã contenir le développement des crises nationales et des processus de masse. Cela implique une reconfiguration des rapports entre les différentes fractions des classes dominantes locales et une réadéquation, avec un minimum de retouches, des rapports avec le capital étranger et l’impérialisme.
Après les journées d’octobre en Bolivie 2003, Mesa est arrivé à la présidence. Il se vantait d’être avant tout indépendant des partis politiques traditionnels. Il s’est surtout caractérisé par son extrême faiblesses et il n’a pu résister aux énormes contradictions auxquelles il avait ã faire face. Bien que beaucoup plus préventif, le changement de personnel politique ayant eu lieu au Brésil n’en était pas moins évident. Pour la première fois un ancien dirigeant ouvrier arrivait à la présidence en tant que représentant d’un front de collaboration de classe. Dans le cas de l’Uruguay, Tabaré Vázquez et le Front Large arrive au pouvoir après des décennies d’alternance politique du vieux bipartisme. En Argentine, le gouvernement de Kirchner occupe le devant de la scène avec un discours plus progressiste, favorisé la reprise économique et appuyé par l’appareil traditionnel du Parti Justicialiste (PJ, péroniste).
Jusqu’à présent ces gouvernements ont remporté un certain succès dans leurs politiques de contention de lutte des exploités. Mais leur stabilité pourrait n’être que passagère dans la mesure où ils n’ont apporté aucune réponse aux problèmes structurels qui affectent les pays de la région et qui ont amené les problèmes économiques et ont généré les explosions sociales auxquelles nous avons fait allusion, notamment la crise argentine et ses répercussions postérieures sur l’économie uruguayenne. Aucun de ces gouvernements n’a apporté une réponse au problème que représente le fardeau de la dette extérieure. C’est le cas de Lula et Tabaré Vázquez qui continuent ã appliquer avec la plus grande orthodoxie les plans du FMI ou même de Kirchner qui prétend avoir solutionné de manière progressiste le problème de la dette extérieure mais a en fait hypothéquer les richesses nationales du pays pour plusieurs générations. Bien qu’ils prétendent être les porte-drapeaux d’une bourgeoisie nationale soi-disant moderne, aucun n’a altéré la structure économique régressive et semi-coloniale de pays où prédomine la pénétration du capital étranger dans le tissu économique, que ce soit dans le secteur industriel ou les services. Ils n’ont pas non plus apporté un remède au gouffre croissant existant entre les revenus de la minorité la plus riche et les secteurs les plus pauvres ou au problème de la concentration latifundiaire et de l’appauvrissement de la paysannerie. Aujourd’hui de surcroît, le gouvernement de Lula est éclaboussé par des scandales dignes de ses prédécesseurs néo-libéraux orthodoxes . Même au Venezuela, le gouvernement de Chávez qui se situe pourtant ã gauche des gouvernements précédents continue ã payer ponctuellement la dette et, si l’on fait exception de quelques concessions minimales, n’a pas résolu le problème de la terre ni celui de la misère qui frappe de plein fouet les pauvres des grandes villes.
Au Mexique, la crise politique récente générée par la tentative d’interdiction de se présenter à la présidentielle contre López Obrador (candidat de centre gauche du Parti Révolutionnaire Démocratique, PRD) remet en lumière la nature véritable des « transitions démocratiques » orchestrées par l’impérialisme au cours des décennies passées. Après soixante dix années de domination du vieux régime priiste , le passage ã un régime « multipartite » sous-tendu par une « transition pactée » entre les trois partis du régime (PRI, PAN et PRD) s’est accompagné d’une subordination toujours plus importante de l’économie nationale à l’impérialisme, notamment par le biais de l’ALENA. Tous les maux structurels de l’arriération semi-coloniale n’ont pas pour autant disparu, ni la misère, ni l’exploitation et l’oppression pesant sur les travailleurs, la paysannerie et les peuples originaires. Cette « démocratie » n’a été qu’une escroquerie des plus élémentaires et légitimes aspirations démocratiques des masses laborieuses mexicaines.
Ce panorama montre bien qu’il n’existe aucune solution aux maux structurels du capitalisme semi-colonial, pas même de conquêtes importantes pour les masses en terme socio-économique, de libertés démocratiques ou d‘indépendance nationale, par le biais des projets politiques réformistes, nationalistes ou progressistes que proposent les Lula, les Tabaré Vázquez, les Kirchner, les Chávez ou les Morales, qui négocient avec la classe dominante et s’adaptent aux marges étroites de la « démocratie pour les riches » semi-coloniale. C’est uniquement la plus large, la plus radicale et la plus généralisée des mobilisations des masses, avec ã sa tête la classe ouvrière menant l’alliance entre les secteurs opprimés et exploités que pourront être satisfaites les revendications les plus élémentaires des travailleurs, des paysans et du peuple pauvre.
Cela souligne l’importance en Amérique latine des revendications comme le non paiement de la dette extérieure, la renationalisation de toutes les entreprises privatisées sous contrôle ouvrier, la lutte pour l’échelle mobile des heures de travail pour en finir avec le fléau du chômage et l‘échelle mobile des salaires pour faire face à l’augmentation du coût de la vie, l’expropriation des grandes propriétés foncières et le partage des terres pour la paysannerie, des mesures essentielles que l’extrême gauche, ã travers son virage de centre-gauche, c’est-à-dire son adaptation au régime bourgeois, a abandonné mais qui aujourd’hui continuent ã faire partie de tout programme qui prétend affronter conséquemment la domination impérialiste à laquelle sont unies par mille liens les bourgeoisies nationales de la région.
Le Brésil : l’escroquerie du réformisme « ouvrier ».
Le gouvernement Lula exprime l’escroquerie des partis ouvriers réformistes qui, en canalisant le mécontentement des classes laborieuses après des décennies d’offensive bourgeoise et impérialiste, se posent en alternative fiable afin de gérer pour le mieux les intérêts capitalistes. L’accession de Lula à la présidence est le résultat, d’une part, de la rupture de la vieille alliance conservatrice qui avait soutenu le gouvernement néolibéral de Fernando Henrique Cardoso, et d’autre part de la peur de la bourgeoisie brésilienne face au danger de contagion argentin, défaut de paiement et journées révolutionnaires comme en décembre 2001. C’est ainsi que le Parti des Travailleurs (PT) le plus important d’Amérique latine a non seulement formé un « gouvernement réformiste sans réformes » mais s’est également transformé en parti gouvernemental de la contre-réforme. Cela s’est traduit par des attaques brutales contre les conquêtes sociales que les masses laborieuses brésiliennes avaient arrachées après des années de lutte contre la bourgeoisie. Six mois après son arrivée au pouvoir, le PT a mené une politique de refonte du système de sécurité social dans son ensemble que même le gouvernement de FHC n’aurait osé mener. Il se préparait ã faire passer d’autres réformes lorsqu’il a été profondément secoué par les scandales de corruption qui ont forcé un de ses principaux ministres, José Dirceu, à la démission.
De larges secteurs du mouvement de masse ont commencé ã perdre les illusions qu’ils avaient en Lula et son gouvernement. Ses politiques anti-ouvrière et anti-populaires ont ouvert un processus de réorganisation dans d’importants secteurs d’avant-garde tant sur le terrain politique que syndical. Ces nouveaux regroupements peuvent être interprétés comme le signe avant-coureur de grands mouvements de masse ã venir. Les classes moyennes qui avaient voté Lula, sensible ã son discours anti-corruption, contre l’enrichissement illicite des fonctionnaires, ont été ébranlé par les scandales de corruption qui ont éclaboussé le gouvernement pétiste. Un symptôme partiel de ces tendances à la rupture sur le plan politique et syndical s’exprime dans l’apparition du Parti Socialisme et Liberté (PSOL) et les mouvements au sein de la Centrale Unique des Travailleurs (CUT) qui s’est transformée en gardienne de l’ordre luliste ainsi que par des ruptures ayant conduit à la création de CONLUTAS (courant syndical dominé par le Parti Socialiste des Travailleurs Unifié, PSTU-LITQI). Mais ces deux phénomènes courent le risque de répéter le cours réformiste du pétisme dans son adaptation à la démocratie bourgeoise, à la conciliation de classe et à la cohabitation avec la bureaucratie syndicale. Lors de ses secondes assises nationales, le PSOL a refusé d’adopter un amendement ã sa résolution nationale qui proposait que le PSOL refuse a priori tout type d’alliance avec des partis bourgeois comme le PDT ou le PSB. La direction du PSOL a les yeux rivés sur les futures élections de 2006. Quant ã CONLUTAS, le PSTU qui dirige le courant syndical couvre par une rhétorique gauchiste son refus de livrer une guerre totale pour l’expulsion de la bureaucratie syndicale de la direction de la CUT et les syndicats qui y sont rattachés de manière ã ce que les travailleurs eux-mêmes les contrôlent et puissent les transformer en de véritables instruments de lutte.
En comparaison avec les 48 millions de salariés, 22 millions d’entre eux étant organisés au sein de la CUT, et en comparaison avec les 53 millions de bulletins de vote “Lula” aux élections présidentielles, on peut clairement voir que ces phénomènes qui se développent aujourd’hui au Brésil sont encore embryonnaires. Face ã cela, il est nécessaire de dépasser les tactiques mesquines et condamnées à l’impuissance et lutter pour que des millions de travailleurs fassent leur expérience avec le pétisme en lançant des politiques transitoires de masse de manière ã ce que les processus de rupture s’enracinent profondément au sein des exploités.
La revendication que la CUT et ses syndicats rompent avec le gouvernement représente une arme puissante afin de balayer la bureaucratie syndicale. Il est nécessaire que les aspirations des travailleurs s’affrontent à la politique menée par cette bureaucratie corrompue. Exiger qu’elle rompe avec le gouvernement et qu’elle ouvre un débat sur la nécessité d’un Parti Ouvrier Indépendant basé sur les syndicats et les organisations ouvrières en lutte aiderait énormément ã ce que les masses fassent leur expérience avec le pétisme et serait le chemin le plus aisé pour l’expulser des syndicats.
L’avant-garde brésilienne commence ã se réorganiser. Depuis que Lula est au pouvoir, elle a mené des luttes importantes et des syndicats, comme nous l’avons vu, rompent avec le gouvernement et la CUT. C’est pour cela qu’il est nécessaire de lutter pour un pôle national antibureaucratique, antigouvernemental et antipatronal qui se transforme en un point d’attraction pour les nouveaux secteurs qui sont disposés à lutter. CONLUTAS peut et doit se transformer en ce pôle si elle est capable de défendre cette politique de lutte pour l’indépendance de classe et de combat pour balayer la bureaucratie syndicale. Ce pôle doit s’adresser aux millions de travailleurs organisés au sein de la CUT et dans les autres centrales syndicales en luttant pour mettre sur pied des fractions révolutionnaires au sein des syndicats.
L’Argentine et la lutte pour l’hégémonie de la classe ouvrière
Avec pour toile de fonds la crise économique qui a postérieurement conduit au défaut de paiement, décembre 2001 en Argentine a été le cadre de journées révolutionnaires qui ont mené au renversement du gouvernement de De La Rúa. Ce pic de la lutte de classe a été la résultante de la combinaison de la lutte massive de la classe moyenne –qui avait été virtuellement expropriée ã travers la congélation de ses comptes bancaires- contre l’état de siège ainsi que le personnel politique traditionnel comme l’exprimait le fameux « ¡que se vayan todos ! [qu’ils s’en aillent tous !] » et la bataille de dizaines de milliers de jeunes d’avant-garde au cours de ce qui s’appellera la Bataille de la Place de Mai ainsi qu’un début d’explosion des pauvres urbains qui ont pillé les grands commerces et les supermarchés. Conséquence de ces événements, le régime bourgeois a connu un moment de dérive, d’affaiblissement de l’autorité étatique et une crise de gouvernabilité de ses institutions fondamentales qui s’est exprimé par un important turn over gouvernementale pendant une courte période .
Sous-produit de ces événements révolutionnaires, de nouveaux acteurs sociaux ont émergé et se sont consolidés, devenant partie intégrante du nouveau panorama politique ouvert après 2001. Le mouvement des chômeurs ou mouvement piquetero s’est renforcé, regroupant une fraction de travailleurs sans-emploi parmi les millions de chômeurs que compte le pays. Les assemblées populaires sont apparues, exprimant les revendications des secteurs de classe moyenne paupérisée. Enfin, bien que minoritaire, on a vu également l’apparition du mouvement d’usines occupées dont l’emblème ont été les luttes et le contrôle ouvrier des usines Zanón et Brukman. Ce mouvement a été un grand fait d’arme de la classe ouvrière d’Argentine, montrant comment lutter face aux fermetures d’entreprises et aux licenciements ã travers la gestion directe de la production. La limite de ce processus n’en a pas moins été l’absence de riposte massive du prolétariat avec ses méthodes de lutte, et cela notamment en raison de la pression terrifiante du chômage et la politique néfaste fondée de trahison de la bureaucratie syndicale. Cette carence s’est manifestée dans le fait que l’alliance entre la classe moyenne et les chômeurs qui s’exprimait ã travers le slogan « piquet et casserole, la lutte est la même ! [¡ piquete y cacerola, la lucha es una sola !] » avait certes un caractère progressiste mais a été incapable de mener une lutte sérieuse contre l’Etat bourgeois. Cela a fait qu’après un premier moment de croissance de la lutte de ces deux secteurs ils aient postérieurement réabsorbés par la relance économique dans le cas de la classe moyenne et par le biais du clientélisme étatique massif dans le cas des chômeurs . Cela montre bien en creux le rôle central de la classe ouvrière pour hégémoniser la lutte contre le capital et son Etat.
Cet élément est absent des conceptions semi-populistes à l’image de celles que véhicule le Parti Ouvrier d’Argentine qui en est arrivé ã identifier le mouvement piquetero comme l’avant-garde du sujet social révolutionnaire. Cette conception revient à liquider la classe ouvrière en tant qu’unité, ã diluer les différents secteurs qui la compose et ã faire abstraction, comme si cela était possible, du pouvoir social qui émane de la production et des services au profit du piquete en tant que force territoriale. Pire encore, le populisme argentin oppose le « territorialisme » à la centralité ouvrière. Au nom de « l’essence révolutionnaire de la pauvreté », on en vient ainsi ã abandonner la lutte pour la conquête de la grande majorité de la classe ouvrière et de ses bataillons centraux qui se concentrent dans les lieux névralgiques des rapports de production capitaliste.
Après une période d’instabilité, l’arrivée au pouvoir de Kirchner armé de sa rhétorique de centre-gauche a permis de restaurer l’autorité de l’Etat et de combler les brèches les plus importantes qu’avaient laissées ouvertes la crise bien que celle-ci subsiste de manière latente. Mais alors que la relance économique bat son plein, la classe ouvrière qui avait été absente des journées révolutionnaires refait aujourd’hui son apparition. La classe ouvrière a recommencé à lutter pour recomposer son pouvoir d’achat. Le paradigme de cette tendance a sans doute été la victoire de la grève des travailleurs du métro de Buenos Aires dirigés par un corps de délégués indépendants de la bureaucratie syndicale. Ce secteur a conflué avec les expressions les plus avancées de la période antérieure à l’image des travailleurs de Zanón qui mènent une lutte héroïque de défense de la gestion ouvrière de leur usine depuis bientôt trois ans, véritable exemple pour l’avant-garde ouvrière nationale et internationale et au sein de laquelle les militants trotskystes du PTS ont joué un rôle important de direction.
Cependant, ce nouveau mouvement ouvrier qui est en train de surgir doit encore résoudre les problèmes qu’a posés 2001 et en premier lieu la lutte pour la coordination des expressions les plus avancées de la classe ouvrière pour que celles-ci puissent se transformer en pôle d’attraction contre la domination traditionnelle de la bureaucratie syndicale sur le reste du mouvement ouvrier. Cette coordination s’est effectivement concrétisée localement et par moment. On pensera notamment à la Coordination [Coordinadora] de l’Alto Valle du Río Negro qui a regroupé plusieurs syndicats et organisations combatives de la province de Neuquén, hégémonisés par Zanon et le syndicat céramiste ou encore à la récente grève des travailleurs du métro de Buenos Aires qui a vu le regroupement de militants des chemins de fer, du secteur de la santé, des télécoms, céramistes, etc.. Il est cependant nécessaire d’aller vers une coordination permanente des secteurs avancés de l’avant-garde. Il est nécessaire de franchir une étape, c’est-à-dire d’avancer vers la lutte pour l’indépendance politique des travailleurs afin qu’ils puissent hégémoniser l’ensemble des secteurs exploités de la nation opprimée. C’est pour cela qu’une des tâches que nous avons devant nous reste le combat pour forger un grand Parti des Travailleurs basé sur les organisations de lutte de la classe ouvrière, les syndicats, les commissions internes, les corps de délégués des grandes entreprises et bien entendu les organisations représentatives des chômeurs indépendantes du gouvernement. Nous parlons d’un véritable parti capable d’arracher les masses à l’influence du péronisme, qui puisse décider du cours des événements dans la vie politique nationale, d’un parti qui puisse exprimer sur le terrain politique la force sociale des dix millions de travailleurs salariés d’Argentine et de ses trois millions de chômeurs.
Bolivie, la nécessité de l’auto-organisation ouvrière et populaire comme contre-pouvoir
La Bolivie montre une tendance récurrente des masses à la lutte et à l’action directe. Depuis la « guerre de l’eau » de Cochabamba en 2000, les masse boliviennes ont fait montre d’une énorme capacité de combat constamment renouvelée. Ils ont eu recours au cours de ces combats ã d’innombrables méthodes de lutte allant des barrages routiers –essentiellement paysans- menant parfois au siège de La Paz, la capitale, à la grève active ouvrière et populaire, accompagnée par la mobilisation de masses convergeant et faisant pression sur les points névralgiques du pouvoir en passant par l’insurrection et ses barricades, lutte de « tout le peuple » comme le disent les Boliviens, disputant le contrôle territorial aux forces de répression allant jusqu’à des actions militaires avancées, expression insurrectionnelle la plus offensive.
La « répétition générale révolutionnaire » d’octobre 2003 a marqué un saut qualitatif par rapport aux processus précédents qui avaient pour acteurs principaux la paysannerie et le mouvement indigéniste . Cette fois, le caractère social plus urbain du soulèvement, la radicalité des méthodes de lutte employées ainsi que le début de l’apparition sur le devant de la scène politique de la classe ouvrière ont impliqué un affrontement plus direct entre les forces sociales fondamentales de la société bolivienne ouvrant ainsi un processus révolutionnaire qui le différenciait du reste des processus ayant eu lieu jusqu’alors en Amérique latine. La combinaison entre soulèvement des masses et processus insurrectionnels spontanés comme dans la grande banlieue populaire de la capitale, El Alto, ont culminé lors de la chute du gouvernement de Sánchez de Lozada et l’arrivée au pouvoir de Carlos Mesa au milieu d’une crise révolutionnaire ouverte au cours de laquelle on a pu voir l’ébauche de quelques éléments de double pouvoir. Cependant, les principales directions politiques, notamment le MAS (Mouvement Vers le Socialisme) d’Evo Morales et le MIP (Mouvement Indigéniste Pachacutic) de Felipe Quispe se sont opposées fermement à la création d’un quelconque front uni que les masses imposaient dans les faits dans la rue et sur les routes du pays. Ils s’opposaient surtout ã ce qu’apparaissent des instances supérieures de front unique des masses organisées démocratiquement qui puissent se poser en organes de pouvoir ouvrier et populaire.
Conséquence de cette situation, ce qui est le plus frappant reste certainement cette disproportion entre la spontanéité de centaines de milliers de Boliviens qui ont occupé le pavé, pleins de détermination et d’initiative, et les institutions existantes du mouvement de masse. Certaines n’organisent en réalité qu’une infime minorité des travailleurs et du peuple bolivien à l’image de la Centrale Ouvrière Bolivienne (COB). D’autres, par leur caractère intrinsèque, n’étaient pas les instruments appropriés pour accompagner le processus insurrectionnel en cours à l’image des comités de quartiers de El Alto (Juntas vecinales regroupés au sein de la Fejuve). Les directions réformistes et bureaucratiques ont quant ã elles défendu ã tout instant les différentes issues possibles dans le cadre du régime démocratique bourgeois et ont appuyé la solution de rechange constitutionnelle et l’arrivée au pouvoir de Mesa de manière ã désarticuler l’expérience révolutionnaire ouverte.
Cependant, la fuite de Sánchez de Lozada a été vécue par les secteurs mobilisés comme une importante victoire. Le gouvernement de Mesa a ainsi souffert d’un énorme handicap dès ses débuts, la faiblesse de son gouvernement étant liée à la manière dont il était arrivé au pouvoir. Au cours d’une première période, il a essayé de gouverner en s’appuyant sur les directions du mouvement de masse, notamment le MAS de Morales. Le MAS faisait ainsi preuve une fois de plus de son caractère conciliateur et défenseur du régime démocratique bourgeois.
La tentative de Mesa de dépasser la situation, pressé néanmoins sur sa droite par la réaction de Santa Cruz et les intérêts de l’impérialisme et les multinationales pétrolières et gazières, a conduit à la rupture du consensus précaire qui lui avait permis d’arriver au pouvoir ainsi qu’a une nouvelle situation de tension entre les classes au cours des premiers mois de l’année 2005 et la première menace de démission de Mesa en mars. Il tentait par cette manœuvre de réunir l’appui suffisant pour garantir la gouvernabilité du pays. L’accord de coulisse passé avec le vieux Parlement avec le soutien des partis politiques discrédités qui dans le passé avaient appuyé Sánchez de Lozada a fait long feu. Le nouveau soulèvement de masses qui réclamait la mise en place de « l’agenda d’octobre » -les revendications du mouvement de masse d’alors-, ce qui passait par la revendication de la nationalisation des hydrocarbures, a mis fin aux dix-huit mois de gouvernement Mesa évitant que l’oligarchie de Santa Cruz ne s’empare du gouvernement par le biais de la succession constitutionnelle qui aurait dû mener au pouvoir Hormando Vaca Díez. Les mineurs et certains secteurs des classes moyennes de La Paz ont fait cause commune pour éviter que ne se consolide ainsi un gouvernement de l’oligarchie crucègne, mais à la différence d’octobre 2003 où la répression avait joué un rôle clef dans la radicalisation des masses altègnes, les Forces Armées ne sont pas cette fois intervenues puisque cela aurait pu conduire ã un nouveau soulèvement révolutionnaire.
A nouveau cependant une issue dans le cadre constitutionnel du régime démocratique bourgeois a été trouvée. Le « vide de pouvoir » a été résolu par le biais de l’arrivée au pouvoir du gouvernement provisoire d’Eduardo Rodríguez, ancien Président de la Cour Suprême, candidat soutenu par l’Eglise, par Mesa et Morales. Mais ces mécanismes de substitution ont rapidement montré leurs limites. Les journées révolutionnaires de juin 2005 ont démontré une fois encore que de larges franges de l’avant-garde et des masses ne pouvaient que manifester un mépris profond pour le Parlement et les institutions du régime politique . La bourgeoisie également divisée et le secteur oligarchique crucègne essayaient en même temps d’imposer leur programme droitier afin d’avancer vers l’autonomie de la région, c’est-à-dire se transformer en intermédiaires directs des multinationales des hydrocarbures.
Ce nouveau point d’orgue dans le processus révolutionnaire ouvert a signifié une expérience importante pour d’importants secteurs du mouvement de masse, notamment ã El Alto qui a été à l’avant-garde du mouvement. Tout d’abord, un débat s’est ouvert quant à la nécessité de créer une Assemblée Populaire qui agisse comme organe de front unique des masses, comme expression du double pouvoir. Sa formation a été décidée par les dirigeants de la Fejuve de El Alto et de la COB sans qu’ils aient réellement eu une politique pour que cette idée prenne corps. Au même moment, la question de l’auto-organisation des masses afin de répondre aux questions ayant trait à la coordination, l’approvisionnement, la direction politique et l’auto-défense militaire a commencé ã se poser. Dans un second temps, les représentants de plus de 500 comités de quartier ont commencé ã se réunir systématiquement ã El Alto. Les secteurs les plus radicalisés de la Fejuve ont parfois réussi ã imposer leur ligne politiques aux dirigeants les plus conciliateurs à l’image d’Abel Mamani. Enfin, les travailleurs de l’usine de gaz liquide de Senkhata qui approvisionne les villes de La Paz et El Alto ont commencé ã discuter de la nécessité de se coordonner avec les Comités de quartier afin d’organiser la distribution en direction des secteurs populaires les plus pauvres et mettre un terme à la spéculation.
Le MAS de Morales a rejoué dans cette crise le même rôle que lors de la crise révolutionnaire d’octobre 2003, le rôle de bouée de sauvetage du régime. En se consolidant comme principal parti d’envergure nationale –comme l’avaient déjà démontré les élections municipales et les mobilisations de mars auxquelles il avait appelé-, le MAS a renforcé son appareil politique, s’est davantage intégré à l’Etat bourgeois, jouant ainsi son rôle de béquille de gauche du régime et de contention des tendances les plus révolutionnaires des masses. Il est sorti de ce conflit avec un groupe parlementaire plus uni et ayant reçu son baptême du feu de la manœuvre parlementaire après s’être mesuré aux politiciens professionnels de la bourgeoisie. En même temps, pressé sur sa gauche par les secteurs les plus avancés des masses et devant affronter une crise de sa propre base, le MAS a été obligé de gauchir son discours ã travers des déclarations plus nationalistes sans pouvoir pour autant imposer son hégémonie sur le secteurs les plus mobilisés comme le démontre El Alto.
La nécessité de construire des organes de pouvoir du mouvement de masse reste un problème stratégique pour les combats ã venir de l’actuel processus révolutionnaire bolivien. C’est en ce sens qu’acquiert toute son importance l’appel à la formation d’une Assemblée Populaire. Il est nécessaire que la COB, la Fejuve et la COR de El Alto, les fédérations de petits paysans colons du Chapare, des Yungas ainsi que les autres organisations en lutte appellent de toute urgence à la formation d’une Assemblée Populaire pour que les travailleurs et le peuple puissent discuter de leurs problèmes, décider d’une position indépendante d’un programme d’actions ã suivre en unifiant la lutte contre le gouvernement à la lutte contre les politiques impulsées par la réaction et l’impérialisme. Il ne s’agit pas de constituer une Assemblée Populaire sur la base d’accords au sommet entre dirigeants mais de la cordonner effectivement en discutant et en s’organisant par en bas. Il est nécessaire de convoquer une Assemblée Populaire avec des représentants élus sur la base de mandats provenant de tous les secteurs ouvriers, paysans, indigènes, de l’Altiplano comme des provinces de l’Est, de chaque entreprise, mine, quartier populaire ou communauté afin de discuter d’un programme ouvrier et paysan face à la crise nationale et d’un plan de lutte qui aboutisse à la grève générale politique avec blocage national des routes afin de reprendre le chemin tracé par Octobre 2003 dans la perspective d’un gouvernement ouvrier et paysan. Voilà la seule manière pour faire aboutir les revendications populaires comme la nationalisation des hydrocarbures sous contrôle des travailleurs et une Assemblée Constituante véritablement libre et souveraine.
En ce sens, le rôle joué par les directions réformistes est plus que néfaste. D’Octobre 2003 jusqu’à aujourd’hui , le MAS a joué le rôle de béquille de gauche du régime en appuyant Mesa et sa politique de réaction démocratique. Aujourd’hui, le MAS sert les objectifs de la contre-révolution en soutenant une « issue institutionnelle » et l’appel aux élections, en s’opposant de toutes ses forces ã ce que les mobilisations aboutissent réellement à la nationalisation du gaz, c’est-à-dire à l’expulsion des multinationales gazières. Tout ceci a été défendu par le MAS au nom de sa stratégie de « réformes en démocratie » c’est-à-dire en agissant dans le cadre du régime en conciliant avec le patronat bolivien, les latifundistes et les multinationales.
Le programme et les méthodes du réformisme “démocratique” liés au discours indigéniste trahissent les intérêts les plus élémentaires des masses des campagnes et des villes qu’il prétend représenter ainsi que la lutte pour la libération nationale.
D’un autre côté, Jaime Solares, leader de la COB, ainsi que d’autres dirigeants au discours plus « rouge » ont recommencé ã s’en remettre, face au vide de pouvoir que laissait la démission de Mesa, au soi-disant patriotisme des Forces Armées en appelant ã une solution civilo-militaire. Cette politique tristement célèbre qui a déjà mené à l’échec comme l’a montré le soulévement équatorien du 21 janvier 2000 alimente des illusions au sujet des Forces Armées et de la police boliviennes, responsables des massacre d’octobre 2003. On prétend démontrer qu’elles pourraient « se placer du côté du peuple ». Cela ne fait qu’entretenir la confusion et désarme les travailleurs face ã toutes les menaces répressives ou putschistes. Morales, Solares et les autres, malgré leurs différences, sont d’accord sur une chose : la stratégie de collaboration de classe avec des secteurs bourgeois et de pression sur le régime. Ce sont les ennemis les plus résolus de la lutte pour une issue politique indépendante menée par les masses ouvrières et paysannes.
Il est nécessaire de forger une nouvelle direction à la tête de nos organisations qui défende une stratégie de mobilisation révolutionnaire des masses basée sur la plus totale indépendance politique des travailleurs et l’alliance ouvrière, paysanne, indigène et populaire contre l’impérialisme et ses alliés.
Il est nécessaire de forger une nouvelle direction, ouvrière et révolutionnaire, ã a tête de la COB et des syndicats. La matière première pour que surgisse cette direction commence ã se former parmi les milliers de travailleurs lutte de classe et dirigeants ouvriers de base qui ã travers les combats d’Octobre par exemple ont accumulé une énorme expérience politique et de lutte. Le combat pour un regroupement de cette avant-garde autour d’une politique d’indépendance de classe de manière ã ce que le monde du travail dirige l’alliance ouvrière, paysanne, indigène et populaire jusqu’à mettre en échec définitivement les multinationales et leurs alliés locaux et imposer par la voie insurrectionnelle une issue ouvrière et paysanne, voilà quel est le grand combat ã venir pour mettre sur pied un grand parti des travailleurs qui renoue avec les meilleures traditions de lutte du prolétariat et des masses de Bolivie de manière ã défendre un programme révolutionnaire, socialiste et internationaliste.
Le Venezuela. La nécessité d’exproprier le grand patronat pour mettre en échec l’impérialisme.
A la suite du délitement du vieux régime politique oligarchique, le Venezuela traverse un cycle d’énorme polarisation sociale et politique. La mobilisation des masses populaires derrière la figure d’Hugo Chávez occupe le devant de la scène. Après des années de néo-libéralisme au cours desquelles la population vénézuelienne a vu son niveau de vie chuter et ses droits politiques foulés aux pieds, elle escompte que ses revendications et attentes deviennent réalité. Les pauvres des villes et des secteurs importants du salariat se sont transformés en protagonistes d’un vaste mouvement social sur lequel le président vénézuelien s’appuie tout en essayant de le contenir par une série de réformes, essayant de mettre sur pied de nouvelles structures politiques institutionnelles face à la banqueroute du régime politique des partis traditionnels.
Cependant, tirant profit de la crise économique internationale, l’oligarchie vénézuelienne qui était en recul passe ã nouveau à l’offensive. Les politiciens de l’ancien régime, la bureaucratie syndicale oppositionnelle de la Centrale des Travailleurs du Venezuela (CTV) ainsi que les dirigeants des chambres de commerce et d’industrie tentent de revenir fébrilement sur le devant de la scène, avec pour objectif d’écarter Chávez du pouvoir. Leur activité contre-révolutionnaire revient également ã pousser les classes moyennes à la mobilisation, ces mêmes classes moyennes qui ont vu leur niveau de vie chuter à la suite des échecs économiques qu’a essuyés le gouvernement.
Mais c’est le mouvement de masse, centralement les pauvres urbains, qui par leurs actions de grande envergure sont sortis dans la rue pour faire face à l’offensive patronale pro-impérialiste qui comptait écarter Chávez du pouvoir. Au cours de l’année 2002 et début 2003, le président vénézuelien a dû affronter une tentative de coup d’Etat et un lockout patronal qui a exacerbé la crise économique que traversait le pays. Dans les deux cas, Chávez et ses ministres se sont retrouvés paralysés, incapables de prendre une quelconque initiative. C’est la mobilisation décisive des travailleurs et du peuple pauvre qui a permis de mettre en échec le coup d’Etat. C’est également grâce à la résistance des travailleurs qui ont réussi ã contrôler la production sur certaines installations de l’industrie pétrolière ou qui se sont opposés au boycott patronal que l’offensive putschiste a été désarticulée.
Ces deux défaites consécutives face à la rue de l’opposition pro-impérialiste qui comptait sur l’appui de l’Etat-major vénézuelien est ce qui a encouragé Chávez ã organiser en mai 2003 sous l’égide et avec la collaboration de l’Organisation des Etats Américains (OEA), le groupe des « pays amis du Venezuela » et la Fondation Carter le référendum qui a eu lieu en août 2004 et duquel le chavisme est sorti renforcé. Le mouvement de masse a de nouveau répondu présent par la suite lors des élections régionales et locales postérieures grâce auxquelles le chavisme a raflé 21 des 23 régions du pays et 239 des 332 municipalités.
Mais ã aucun moment, même après les tentatives putschistes contre-révolutionnaires, Chávez ne s’est proposé de toucher aux intérêts de la bourgeoisie golpiste ou de l’impérialisme, c’est-à-dire leur pouvoir économique, leurs banques et leurs grandes entreprises alors qu’il s’agissait précisément de leur asséner un coup décisif. Bien au contraire, au lieu de se proposer de mettre en échec le grand patronat et l’impérialisme sur le territoire national, Chávez a appelé constamment à la conciliation avec les secteurs bourgeois disposés au dialogue puisque son objectif n’est autre que favoriser et développer une bourgeoisie nationale fonctionnelle ã ses projets politiques. A aucun moment il n’a cessé de payer la dette extérieure frauduleuse contractée sous le vieux régime oligarchique qui condamne le pays à l’arriération et qui représente un mécanisme de spoliation impérialiste. Ainsi après le coup d’Etat, Chávez a renvoyé chez elles les masses qui l’ont porté au pouvoir et l’ont défendu, s’asseyant par la suite à la table de négociation pour « dialoguer » avec les représentants de l’opposition mais aucun représentant de la classe ouvrière ni des pauvres urbains ou de la paysannerie. Ce qui est sûr c’est que le président vénézuelien a besoin de s’appuyer sur les masses et leur mobilisation mais empêcher également que celle-ci n’acquièrent une dynamique indépendante.
Pour utiliser une image, on peut dire que Chávez a tenté de « s’élever » au dessus des classe sociales afin de jouer un rôle d’arbitre entre les intérêts du capital étranger et du capital national, les intérêts du capital dans son ensemble et ceux des masses exploitées afin d’essayer de concilier ces forces antagoniques. Les concessions faites au mouvement de masse grâce à la rente pétrolière ainsi que la quête d’une marge de manœuvre plus importante par rapport au capital étranger sont les éléments qui nous permettent d’affirmer que le régime chaviste a des traits bonapartistes sui generis de gauche, mais il est loin des régimes bonapartistes sui generis traditionnels qui ont été ceux de Cárdenas au Mexique dans les années 1930 ou de Perón en Argentine dans les années 1940. A la différence de ce dernier qui s’appuyait sur le rôle des syndicat et de la classe ouvrière dans ses manœuvres contre l’impérialisme nord-américain, Chávez s’appuie surtout sur les pauvres urbains et les Forces Armées ce qui donne ã son régime un caractère plus timoré par rapport aux gouvernements précédemment cités qui en sont arrivés ã nationaliser d’importants secteurs de l’économie nationale et ont connu des affrontements importants avec l’impérialisme. C’est pour cela que l’objectif de Chávez consiste avant tout ã redéfinir ses relations avec Washington de manière ã négocier dans de meilleures conditions les termes de leur rapport sans rompre bien entendu pour autant les liens fondamentaux de la subordination semi-coloniale du pays dans le cadre de l’ordre impérialiste.
Cependant, la situation vénézuelienne reste ouverte car les contradictions qu’elle recouvre laissent entrevoir de nouveaux affrontements entre classes. L’impérialisme menace de manière permanente le Venezuela et la seule manière de le mettre en échec c’est avant tout d’exproprier la bourgeoisie locale et le capital étranger.
Mais cette tâche ne peut être menée ã bien que par la classe ouvrière, hégémonisant et à la tête d’une alliance révolutionnaire avec le reste des secteurs exploités puisque le chavisme, de par son caractère de classe, ne le fera jamais. C’est pour cela qu’il est nécessaire de lutter pour l’expropriation des principales multinationales et entreprises du pays et les remettre aux mains des travailleurs, de la paysannerie et des pauvres des villes afin d’organiser l’économie en fonction des nécessités des masses laborieuses. C’est la classe ouvrière et elle seule qui est capable de mener conséquemment la lutte de la nation opprimée contre l’impérialisme.
C’est pour cela que loin de préconiser la subordination politique des travailleurs au chavisme et au timide programme de réformes de la “révolution bolivarienne” comme le fait la quasi-totalité des courants d’extrême gauche, il est urgent et nécessaire de développer la lutte pour une politique ouvrière indépendante conséquente contre la réaction vénézuelienne et l’impérialisme, expliquant néanmoins patiemment qu’il est nécessaire de se défier de la politique chaviste et de son projet nationaliste.
Sur le plan international Chávez a proclamé la nécessité de « l’unité bolivarienne ». Il lance cette proposition démagogique dans toutes les rencontres intergouvernementales ou bilatérales latino-américaine et c’est ainsi également qu’il les présente au mouvement de masse. En tant que marxistes révolutionnaires, nous luttons pour rompre avec l’arriération et l’esclavage auxquels nous soumet l’impérialisme et pour une puissante fédération des pays latino-américains. Mais ce n’est certainement pas la bourgeoisie latino-américaine, arriérée, unie par mille et un liens à l’impérialisme qui mènera ã bien ce combat. Ces bourgeoisies ne peuvent ni ne pourront développer l’unité latino-américaine. Au cours des dernières décennies nous avons même vu comment elles se sont encore plus transformées en agents du capital étranger. Elles se contentent tout juste de marchander face aux exigences les plus brutales de l’impérialisme, espérant ainsi améliorer les termes de l’échange inégal mais cela pour leur propre compte et non pas pour celui des masses exploitées du continent, et toujours dans le cadre de la subordination à l’impérialisme bien entendu. Sans rupture avec cet ordre il est évidemment impossible ne serait-ce que de se proposer d’en finir avec la misère, l’arriération et les autre tares du capitalisme semi-colonial. C’est pour cela que nous réaffirmons que la lutte contre l’impérialisme qui est inséparable de la lutte contre ses alliés locaux, les bourgeoisies nationales, ne peut se livrer conséquemment qu’à la condition exclusive que le prolétariat dirige l’ensemble des masses opprimées dans les différents pays. Contre la démagogie sudaméricaniste ou bolivarienne des nationalistes ou des réformistes, nous soulignons que l’unification économique et politique nécessaire de l’Amérique latine en une puissante fédération ne sera réalisable que par la classe ouvrière à la tête des exploités et des opprimés prenant entre ses mains la lutte continentale contre l’impérialisme. C’est pour cela que la consigne principale pour atteindre cet objectif reste la lutte pour la Confédération des Républiques Socialistes d’Amérique latine et de la Caraïbe.
Cuba, un enjeu central pour les révolutionnaires latino-américains
Cuba continue ã être un Etat ouvrier, bien que profondément déformé et affaibli. Les conquêtes fondamentales de la révolution ont été érodées mais n’ont pas été détruites. Le noyau fondamental de l’économie continue ã être contrôlé par l’Etat. Les rapports de propriété nés au lendemain de la révolution, le rapport de force entre les classes et la conscience « égalitaire » et anti-impérialiste des masses sont un énorme obstacle pour le processus de restauration.
La stratégie nord-américaine consistant ã contrôler plus étroitement le monde semi-colonial par le biais d’une politique basée sur une domination militaire et politique plus directe –ce qui signifie un saut dans le processus de recolonisation du continent sud-américain- entre en contradiction avec l’existence même d’un Etat ouvrier ã Cuba que les milieux dirigeants ã Washington considèrent comme une entrave de leurs projets pour la région. En ce sens, étrangler la révolution cubaine reste une priorité stratégique pour les Etats-Unis. Faire pression dans le sens de la « transition démocratique » est un des objectifs déclarés de l’impérialisme. Pour ce faire, il s’appuie sur la « dissidence » interne de droite afin de garantir le passage le plus ordonné possible vers la restauration capitaliste. L’Union Européenne a commencé ã soutenir plus ouvertement la politique de « transition » et ã soutenir financièrement la « dissidence ». Cela fait des année que l’Espagne et les autres puissances impérialistes européennes dans le cadre des rivalités commerciales inter-impérialistes rendant le marché cubain extrêmement attractif se sont différenciés de la politique d’embargo de Washington. Les échanges commerciaux avec l’île sont très importants dans la mesure où les bourgeoisies européennes ont soutenu les investissements de leurs trusts ã Cuba. Tout au long de cette période, les pays européens réclamaient une « ouverture démocratique » qui permette l’organisation ouverte des forces restaurationnistes sur l’île tout en maintenant cependant de bons rapports diplomatiques avec Castro sans pour autant défendre une ligne d’appui actif à l’opposition intérieure comme ils le font actuellement.
La ligne politique adoptée par Castro ne fait que renforcer les tendances pro-capitalistes et affaiblir les résistances de l’économie nationalisée et l’énergie et la disposition des masses à lutter contre le siège impérialiste. L’impérialisme tire profit de l’isolement et des concessions faites par le castrisme afin d’augmenter la pression de manière ã pousser pour aller dans le sens d’une « transition » nécessaire afin de permettre la recolonisation de l’île.
Cette recolonisation est loin d’être inévitable. L’élément central reste que la révolution est toujours en vie aujourd’hui. Sa capacité de résistance n’a été détruite ni par le blocus impérialiste ni par la désastreuse politique de la bureaucratie castriste. Les travailleurs et le peuple cubains ont démontré pendant plus de quatre décennies leur héroïsme et leur extraordinaire capacité de résistance. En ce sens, la stratégie impérialiste restaurationniste devra affronter bien des obstacles pour s’imposer définitivement. Le prolétariat cubain, la force sociale décisive de l’île, a besoin de se préparer pour revenir sur le devant de la scène politique et prendre en main le destin de Cuba, renversant la bureaucratie qui capitule face à l’impérialisme et qui liquide tous les jours un peu plus les conquêtes de la révolution alors qu’elle maintient sa domination.
Face au siège impérialiste –contre le blocus et toutes les autres formes d’agression-, le point de départ du marxisme révolutionnaire est la défense inconditionnelle de l’Etat ouvrier en dépit de ses graves déformations bureaucratiques et son gouvernement. En cas d’agression militaire, nous sommes inconditionnellement dans le camp de Cuba pour la défaite de l’impérialisme. En aucun cas cela signifierait donner un appui politique quelconque à la direction castriste qui mène les conquêtes révolutionnaires à la ruine, démoralise les masses et ouvre le chemin de la restauration capitaliste. Il est impossible de séparer la lutte contre l’impérialisme des tâches de la révolution politique de manière étapiste. La défense de la révolution signifie une lutte intransigeante contre la domination de la bureaucratie et pour un régime de démocratie ouvrière.
Dans la mesure où les conquêtes fondamentales de la révolution subsistent même de manière affaiblies, le programme pour une nouvelle révolution ã Cuba sera essentiellement politique, se combinant ã des tâches ã caractère social en raison de la nécessité de combattre les éléments semi-capitalistes et capitalistes qui sont apparus. Les éléments essentiels de notre programme viseront naturellement à limiter les éléments marchands et les concessions réalisées dans les limites du compatible avec les intérêts de la révolution, la défense et l’élargissement des bases de l’économie nationalisée, le renforcement du prolétariat comme classe socialement et politiquement dominante. C’est uniquement ainsi que l’on pourra ouvrir la route de la construction du socialisme.
Une révision radicale de la politique économique est cependant nécessaire. Les travailleurs ont le droit d’exiger la révision des concessions faites au capital étranger en accord avec les intérêts de la révolution. Il faut rétablir le monopole du commerce extérieur. Les travailleurs ã qui la bureaucratie castriste réclame des efforts et des sacrifices au nom de la « bataille de la production » doivent avoir le droit de contrôler et de décider au sujet de toutes les questions centrales de la production et de l’approvisionnement, à l’échelle des entreprises comme ã échelle nationale. Le salaire des travailleurs doit augmenter, les inégalités doivent être réduites au minimum compatible avec les nécessités de la transition au socialisme. Cela serait possible en adoptant une politique opposée aux revenus des hauts fonctionnaires castristes et des nouveaux riches et allant à l’encontre des coûts excessifs que génère la gestion bureaucratique. La politique de réforme actuelle doit être remplacée par une nouvelle politique économique en accord avec les intérêts des travailleurs des campagnes et des villes et visant ã renforcer l’économie nationalisée en fonction du principe de planification démocratiquement centralisée.
Un élément clef du programme pour la révolution politique reste la lutte pour la légalité de tous les courants politiques défendant la révolution cubaine et la lutte pour la plus grande liberté politique et d’organisation pour les masses cubaines. L’assainissement de l’économie cubaine passe avant tout par la plus grande liberté d’organisation pour les travailleurs, ã commencer par l’abolition de toute la législation et statuts consacrant le « rôle dirigeant » du Parti Communiste Cubain (PCC) dans les syndicats et autres organisations de masse. Les ouvriers doivent récupérer leur plein droit de grève, d’autonomie de leurs syndicats et le droit ã créer de nouveaux syndicats ou comités d’usine et d’entreprise. Ils doivent lutter pour la pleine liberté de parole, de réunion et de presse pour les travailleurs cubains. La jeunesse, une des premières victimes du climat d’oppression politique, doit avoir droit aux libertés politiques, culturelles et d’organisation les plus larges.
Il faut en finir avec le monopole politique du PCC et son rôle de « parti-Etat ». Il n’y aura pas de véritable démocratie pour les masses laborieuses sans droit de s’organiser indépendamment du PCC. Combattre l’oppression politique du régime castriste ne signifie pas accepter le discours démagogique de la « démocratie à l’état pur », c’est-à-dire la démocratie bourgeoise, cheval de Troie de l’impérialisme pour imposer ses projets de « transitions », c’est-à-dire de contre-révolution travestie démocratiquement. Le bonapartisme bureaucratique du régime cubain et de ses institutions, comme l’Assemblée Populaire Nationale, doit être remplacé par une authentique démocratie ouvrière révolutionnaire basée sur les organes de pouvoir des travailleurs, démocratiquement organisés de bas en haut, intégrés par des représentants élus directement sur mandat, qui puissent être révoqués ã tout moment et dont le salaire ne dépasse pas celui d’un qualifié.
La politique extérieure cubaine doit s’inspirer de l’internationalisme ouvrier authentique et non de la « coexistence » avec l’impérialisme et l’appui sur les bourgeoisies « amies » du Tiers-Monde. Plus que jamais, le destin de la révolution cubaine est lié au développement de la lutte de classes en Amérique latine et dans le monde. Les travailleurs et la jeunesse de l’île doivent tisser des liens solides avec les classes laborieuses et la jeunesse d’Amérique latine et des Etats-Unis dans une lutte commune cotre l’impérialisme. Le plus grand obstacle sur cette voie reste le castrisme et ses alliés staliniens et réformistes du continent qui, alignés sur une stratégie de collaboration avec la bourgeoisie, ont entaché le drapeau de l’internationalisme prolétarien. Aujourd’hui, la défense de la révolution cubaine exige qu’elle se transforme en fer de lance de la révolution continentale. L’unité économique et politique avec d’autres pays de la région serait le point de départ nécessaire pour mettre un terme à l’isolement de l’île. Mais cette unité ne peut être menée ã bien qu’à travers une politique de classe. Les travailleurs doivent prendre la tête de la lutte continentale pour l’expulsion de l’impérialisme ã travers la consigne du combat pour une Confédération de Républiques Socialistes d’Amérique latine et de la Caraïbe.
Les travailleurs cubains ont besoin d’une nouvelle direction. Le PCC et le régime castriste ne peuvent « s’auto-réformer », c’est pourquoi il est nécessaire de lutter pour le renversement de la bureaucratie cubaine. Les secteurs pro-bourgeois et pro-impérialistes d’opposition ainsi que l’Eglise utilisent les revendications démocratiques afin d’essayer de capitaliser le ras-le-bol et le mécontentement générés par la situation économique et l’oppression politique asphyxiante que fait peser le castrisme. Afin de combattre ces tentatives droitières et aider le prolétariat cubain ã prendre dans ses mains le destin de la révolution, il est nécessaire de construire une véritable opposition ouvrière, marxiste et internationaliste, c’est-à-dire construire un véritable parti ouvrier révolutionnaire armé d’un programme pour la révolution politique afin d’arracher le pouvoir à la bureaucratie et imposer un régime de démocratie ouvrière nécessaire pour ouvrir la route de la construction du socialisme.
4. POUR LA REVOLUTION OUVRIERE ET SOCIALISTE ET LA DICTATURE DU PROLETARIAT
L’expérience historique de la lutte de la classe ouvrière internationale depuis la Commune de Paris jusqu’à la Révolution russe d’octobre 1917 et les révolutions du XX° siècle montrent que la bourgeoisie défendra par tous les moyens possibles son pouvoir par le biais de son Etat et ses rouages répressifs. Les travailleurs pourront renverser le capitalisme uniquement par le biais d’une insurrection violente qui sache briser et mettre en échec l’armée et la police, détruire l’Etat bourgeois et établir sur ses ruines leur propre pouvoir, un Etat ouvrier de transition basé sur les organes d’autodétermination du prolétariat et des masses exploitées et l’armement général de la population. Cet Etat se base sur l’établissement de nouveaux rapports sociaux qui naissent de l’expropriation et de la nationalisation des principaux moyens de production, le monopole du commerce extérieur, la planification économique et la transition vers le socialisme, étendant ses fonctions à l’ensemble des masses laborieuses organisées en soviets, créant ainsi les bases de sa propre extinction. De même que l’Etat bourgeois, au-delà de ses formes politiques –parlementaires ou dictatoriales- constitue la dictature de la classe bourgeoise sur le prolétariat et la majorité de la population expropriés de leurs moyens de subsistance, l’Etat ouvrier constitue la dictature du prolétariat, c’est-à-dire la domination politique de la classe ouvrière à la tête d’une alliance avec le reste des classes subalternes, contre l’infime minorité d’exploiteurs, expropriés de leur pouvoir politique et économique.
Après la chute du stalinisme, la bourgeoisie, ã travers ses partis politiques, les directions bureaucratiques de la classe ouvrière et ses intellectuels organiques, s’est chargée de diffuser le lieu commun selon lequel il n’existerait aucun régime politico-social autre que celui de la démocratie bourgeoise et que toute révolution socialiste conduit inévitablement au « totalitarisme », mettant sur un pied d’égalité la dictature du prolétariat et les régimes ã parti unique. Même les théoriciens « anti-capitalistes » ou soi-disant communistes ont cédé ã cette mode, troquant la stratégie de la révolution ouvrière et de la prise du pouvoir politique par le prolétariat contre un pseudo « contre-pouvoir » qui ne se proposerait pas de détruire le pouvoir étatique ni la propriété capitalistes et laisserait par conséquent sur pied le pouvoir bourgeois.
Du point de vue marxiste, au lieu de combattre le lourd legs du stalinisme en revendiquant la meilleure des traditions trotskystes, celle du combat ã mort contre le stalinisme et de la lutte pour renouer avec la stratégie soviétiste, le Secrétariat Unifié de la Quatrième Internationale (SUQI) ainsi que d’autres courants moins importants se réclamant du trotskysme renient ouvertement la révolution en théorisant que la société de transition et l’Etat ouvrier lui-même renferment les germes du totalitarisme bureaucratique. Au cours de son avant-dernier congrès de 2003, la Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR, section française du SUQI) a renoncé complètement à la lutte pour la dictature du prolétariat, lui substituant le combat pour la « démocratie jusqu’au bout », symptomatique de sa profonde adaptation à la démocratie bourgeoise.
Contre cette adaptation vulgaire, nous soutenons que la dictature du prolétariat reste la clef de la stratégie marxiste pour renverser la bourgeoisie. Pour les marxistes révolutionnaires, la dictature du prolétariat est synonyme d’un nouveau type de démocratie, la démocratie prolétarienne basée sur des organes d’autodétermination des masses, les soviets ou conseils ouvriers. C’est là la forme politique la plus démocratique de domination de la classe ouvrière qui aura besoin d’un Etat ouvrier transitoire tant qu’existeront l’impérialisme et les classes ennemies et que la question de la nécessité de la défense de la révolution face aux attaques de la réaction bourgeoise interne et externe continuera de se poser.
Dans sa lutte implacable contre le stalinisme, Trotsky a développé au cours des années 1930 les bases d’un programme révolutionnaire pour la société soviétique et pour la société de transition en général, montrant clairement qu’une alternative au stalinisme existait et que la domination bureaucratique n’était pas inévitable. Ce programme, dont les principes centraux sont la démocratie soviétique, la planification économique combinée aux mécanismes permettant de contrôler le bon fonctionnement du plan ainsi que la lutte pour la révolution socialiste internationale conserve aujourd’hui toute son actualité au moment de penser ã des lignes directrices pour une société de transition au socialisme.
La démocratie soviétique est indissolublement liée à la démocratie économique. Comme le soulignait Trotsky pour l’URSS, « la démocratie soviétique n’est pas une revendication politique abstraite ou morale. C’est une question de vie ou de mort pour le pays ». Il en est ainsi dans la mesure où dans une économie nationalisée –dans laquelle le marché continue ã exister mais perd progressivement de l’importance alors que la capacité de planification avance- la qualité signifie nécessairement la démocratie des producteurs et des consommateurs de manière ã permettre de corriger les erreurs de production par le biais de la critique et la participation ouvrière et populaire au processus productif.
La bureaucratie stalinienne a liquidé tout organe de pouvoir ouvrier et populaire et s’est approprié de la machine étatique, instaurant une dictature de parti unique qui exerçait sa domination par le biais de la terreur. Le processus économique s’est progressivement libéré de tout mécanisme de contrôle. Les statistiques étaient truquées par la caste au pouvoir ou les bureaucrates de manière ã atteindre les objectifs fixés par le plan. Pour Trotsky, la combinaison de la planification démocratique des principaux instruments économiques avec l’action « régulatrice » du marché constituaient un mécanisme qui pouvait contrôler et dans une certaine mesure permettre de réaliser le plan, mettant à l’épreuve l’efficacité des départements de planification ã travers le calcul commercial.
Cela devait se compléter par une monnaie forte, stable et convertible qui agirait en dernière instance comme un moyen de mesure objectif de la productivité du travail et comme indice réel de l’état de l’économie.
Cette combinaison reste aujourd’hui centrale pour la transition. Il s’agirait d’utiliser les mécanismes correcteurs du marché en tenant compte de ses distorsion de manière ã freiner les disproportions de l’économie et disposer d’un instrument de comparaison avec le marché mondial de la productivité de l’économie planifiée,
Dans la société de transition, le fonctionnement des soviets est ce qui permet, ã travers le processus de liberté de parole et de critique, d’atteindre un équilibre relatif entre les nécessités que pose le développement ã un moment donné des forces productives, l’effort requis et la réduction progressive de la journée de travail. De même, la libre critique des consommateurs est nécessaire pour atteindre une qualité acceptable des biens et des services produits et offerts. Dans un Etat ouvrier révolutionnaire de transition qui cherche ã développer les éléments socialistes présents au sein de la propriété nationalisée, la planification de l’économie n’a rien ã voir avec l’économie planifiée à la stalinienne. Elle nécessite la participation consciente des producteurs et consommateurs ã travers des conseils ouvriers.
L’expérience stalinienne a complètement perverti le rapport entre les organes de front unique de masse –les soviets- et le parti révolutionnaire. Elle a transformé la dictature du prolétariat en la dictature du parti stalinien.
A ce régime de parti unique, Trotsky a opposé le pluralisme soviétique comme norme programmatique. Il se basait pour cela sur l’existence d’autres classes non exploiteuses au sein de la société de transition, comme la paysannerie, et sur l’hétérogénéité de la classe ouvrière. C’est cette même hétérogénéité sociale qui pose le problème de la nécessité d’un parti ouvrier révolutionnaire qui lutte consciemment pour la réalisation des buts de la révolution et gagne la direction au sein des organismes soviétiques.
L’échec du stalinisme montre l’impossibilité de développer le socialisme dans les limites des frontières nationales. Si la révolution allemande avait triomphé, le prolétariat de ce pays avancé aurait certainement assisté la jeune révolution russe, souffrant de l’arriération nationale et de l’encerclement impérialiste.
La conquête du pouvoir par le prolétariat n’est que le début d’un processus de transformation de tous les aspects de la vie économique, politique et sociale d’un pays. En même temps, c’est un point d’appui pour l’extension de la révolution socialiste sur le terrain international. Seul le renversement du capitalisme dans ses centres vitaux rendra le socialisme possible en tant que projet d’émancipation de l’humanité de l’exploitation et de l’oppression. Cela permettra d’avancer vers la conquête définitive du « royaume de la liberté » qui consiste en une société basée sur la disparition du travail salarié, de la marchandise, la monnaie et l’Etat, une société communiste.